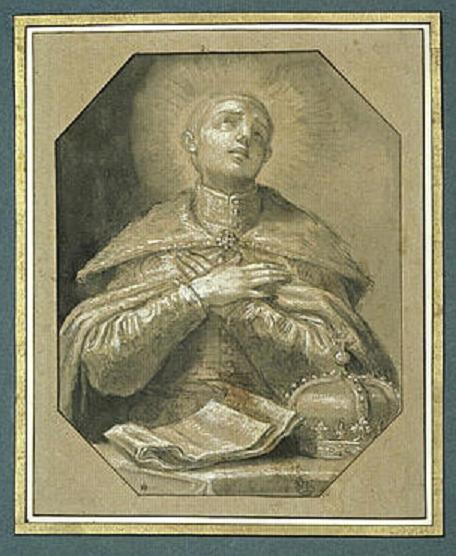mardi, 04 mars 2025
4 mars. Saint Casimir, duc de Lithuanie, confesseur. 1483.
- Saint Casimir, duc de Lithuanie, confesseur. 1483.
Papes : Pie II, Sixte IV. Empereur d'Allemagne : Frédéric III.
" La chasteté est la vertu qui représente ici-bas l'état glorieux de l'immortalité."
St. Bernard, Ep. XLIII, à Henri, archv. de Sens.

Saint Casimir de Lithuanie. Anonyme. XVIIe.
C'est du sein même d'une cour mondaine que l'exemple des plus héroïques vertus nous est offert aujourd'hui. Casimir est prince de sang royal ; toutes les séductions de la jeunesse et du luxe l'environnent ; cependant, il triomphe des pièges du monde avec la même aisance que le ferait un Ange exilé sur la terre. Profitons d'un tel spectacle ; et si, dans une condition bien inférieure à celle où la divine Providence avait placé ce jeune prince, nous avons sacrifié à l'idole du siècle, brisons ce que nous avons adoré, et rentrons au service du Maître souverain qui seul a droit à nos hommages. Une vertu sublime, dans les conditions inférieures de la société, nous semble quelquefois trouver son explication dans l'absence des tentations, dans le besoin de chercher au ciel un appui contre une fortune inexorable : comme si, dans tous les états, l'homme ne portait pas en lui des instincts qui, s'ils ne sont combattus, l'entraînent à la dépravation. En Casimir, la force chrétienne paraît avec une énergie qui montre que sa source n'est pas sur la terre, mais en Dieu.

Statue de saint Casimir. Statuaire populaire lithuanienne.
C'est là qu'il faut aller puiser, dans ce temps de régénération. Un jour, Casimir préféra la mort au péché. Fit-il autre chose, dans cette circonstance, que ce qui est exigé du chrétien, à toute heure de sa vie ? Mais tel est l'attrait aveugle du présent, que sans cesse on voit les hommes se livrer au péché qui est la mort de l'âme, non pas même pour sauver cette vie périssable, mais pour la plus légère satisfaction, quelquefois contre l'intérêt même de ce monde auquel ils sacrifient tout le reste. Tel est l'aveuglement que la dégradation originelle a produit en nous. Les exemples des saints nous sont offerts comme un flambeau qui doit nous éclairer : usons de cette salutaire lumière, et comptons, pour nous relever, sur les mérites et l'intercession de ces amis de Dieu qui, du haut du ciel, considèrent notre dangereux état avec une si tendre compassion.
Casimir, fils de Casimir, roi de Pologne, et d'Elisabeth d'Autriche, fut élevé dans la piété et les belles-lettres par d'excellents maîtres. Dès sa jeunesse, il domptait sa chair par un rude cilice et par des jeûnes fréquents. Dédaignant la mollesse d'un lit somptueux, il couchait sur la terre nue, et s'en allait secrètement au milieu de la nuit implorer, prosterné contre terre, la divine miséricorde, devant les portes des églises. La Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ était l'objet continuel de sa méditation, et il assistait à la sainte Messe avec un esprit tellement uni à Dieu, qu'il semblait ravi hors de lui-même.

Saint Casimir. Anonyme. XVIe.
Il s'appliqua avec un grand zèle à l'augmentation de la foi catholique et à l'extinction du schisme des Ruthènes : c'est pourquoi il porta le roi Casimir son père à défendre par une loi aux schismatiques de bâtir de nouvelles églises, et de réparer les anciennes qui tombaient en ruine. Libéral et miséricordieux envers les pauvres et tous ceux qui souriraient quelque misère, il s'acquit le nom de père et de défenseur des indigents. Ayant conservé intacte la virginité depuis son enfance, il la défendit courageusement sur la fin de sa vie, lorsque, pressé par une grande maladie, il résolut fermement de mourir plutôt que de rien faire contre la chasteté, en acceptant les conseils des médecins.

Statue de saint Casimir. Cathédrale Saint-Stanislas de Vilnius.
Ayant ainsi consommé sa course en peu de temps, plein de vertus et de mérites, après avoir prédit le jour de sa mort, il rendit son âme à Dieu, entouré de prêtres et de religieux, en la vingt-cinquième année de son âge. Son corps fut porté à Vilna, où il éclate par un grand nombre de miracles. Une jeune fille qui était morte recouvra la vie au tombeau du saint; les aveugles y reçurent la vue, les boiteux la marche, et de nombreux malades la santé. Il apparut dans les airs à une armée lithuanienne effrayée de son petit nombre, au moment de l'invasion inopinée d'un ennemi puissant, et il lui fit remporter une victoire signalée. Frappé de tant de merveilles, Léon X inscrivit Casimir au catalogue des Saints.
PRIERE
" Reposez maintenant au sein des félicités éternelles, Ô Casimir, vous que les grandeurs de la terre et toutes les délices des cours n'ont pu distraire du grand objet qui avait ravi votre cœur. Votre vie a été courte en durée, mais féconde en mérites. Plein du souvenir d'une meilleure patrie, celle d'ici-bas n'a pu attirer vos regards ; il vous tardait de vous envoler vers Dieu, qui sembla n'avoir fait que vous prêter à la terre. Votre innocente vie ne fut point exempte des rigueurs de la pénitence : tant était vive en vous la crainte de succomber aux attraits des sens !
Faites-nous comprendre le besoin que nous avons d'expier les péchés qui nous ont séparés de Dieu. Vous préférâtes mourir plutôt que d'offenser Dieu ; détachez-nous du péché, qui est le plus grand mal de l'homme, parce qu'il est en même temps le mal de Dieu. Assurez en nous les fruits de ce saint temps qui nous est accordé pour faire enfin pénitence. Du sein de la gloire où vous régnez, bénissez la chrétienté qui vous honore ; mais souvenez-vous surtout de votre patrie terrestre. Autrefois, elle eut l'honneur d'être un boulevard assuré pour l'Eglise contre le schisme, l'hérésie et l'infidélité ; allégez ses maux, délivrez-la du joug, et, rallumant en son sein l'antique zèle de la foi, préservez-la des séductions dont elle est menacée."
00:15 Publié dans C | Lien permanent | Commentaires (1)
lundi, 03 mars 2025
3 mars. Saint Guénolé, abbé et fondateur de l'abbaye de Landévennec. 504.
- Saint Guénolé, abbé et fondateur de l'abbaye de Landévennec. 504.
Pape : Saint Symmaque. Roi de Cornouailles : Grallon. Roi de France : Clovis Ier.
" Plein d'austérité pour lui-même, il n'était point dur envers les autres ; il avait le caractère facile, l'humeur toujours égale : son visage empreint de douceur ne subissait pas les vicissitudes de l'hilarité et de la tristesse."
Propre de Quimper.

Saint Guénolé. Chapelle Saint-Guénolé. Quistinic. Bretagne. XVIIe.
Le père de saint Guénolé s’appelait Fragan. Né au Pays-de-Galles, il était de noble extraction puisqu'il était parent de Conan Mériadec, que beaucoup regardent comme ayant été le premier roi de Bretagne-Armorique. Au début du Ve siècle, il émigra en Armorique lorsque les Romains, et avec eux un bon nombre de Bretons, quittèrent la Bretagne insulaire, et, abordant d'abord sur l'île de Bréhat, s’arrêta enfin sur les rives du Gouët aux environs de Saint-Brieuc en un lieu appelé aujourd’hui Ploufragan. Il était accompagné de ses deux jeunes fils, les futurs saint Jacut et saint Guéthenoc et de leur mère, sainte Gwenn, que l’on représente souvent avec trois mamelles, selon le nombre de ses fils. A peine arrivée, Gwenn donne naissance à son troisième fils, le futur abbé de Landévennec, en 418 ou 419. Fragan et Gwenn eurent encore une fille, plus tard, Creirvie.
Fragan et Gwenn avait fait vœu d'offrir saint Guénolé au Seigneur. Eduqué selon son rang, l’enfant manifesta très tôt des dispositions brillantes, et surtout une aptitude supérieure à la louange du Seigneur. Tout petit, il demanda à son père de le confier à quelque ancien, qui l’instruirait des choses de Dieu. Las, Fragan refusa, méprisant par-là son ancien vœu. Un jour où il visitait ses terres, il fut pris dans un orage épouvantable. Ses gens le virent dans une espèce d'extase pendant laquelle ils l'entendirent s'exprimer ainsi :
" Seigneur, Ils sont tous à vous, non seulement Guénolé, mais aussi Guethenoc et Jacut, mais aussi Creirvie, mais aussi leur père et leur mère !"
Quelques temps plus tard, Fragan emmena saint Guénolé au saint et vieux moine Budoc, sur l’île des Lauriers, entre l'embouchure de la rivière du Trieu et l'île de Bréhat, et appelée aujourd'hui l'île Verte. En chemin, les voyageurs furent pris par une brutale tempête, notre petit saint Guénolé s’empressa de la calmer par le signe de la croix.

Sous l’égide de saint Budoc, Guénolé apprend bien vite les lettres, et en quelques années devient " un éminent connaisseur accompli des Saintes Ecritures ". Sa sainteté se révèle dès la jeunesse, lorsque Guénolé guérit un camarade tombé en l’absence de l’abbé. Guénolé se distinguait par son humilité et son amour des pauvres qu’il secourt, guérit, console, nourrit, à l’insu de tous, leur enseignant l’Evangile. A un frère qui lui faisait des reproches sur ses enseignements aux pauvres, Guénolé répond tout joyeux :
" Béni sois-tu, frère très aimé, car tu as vraiment proféré contre moi le témoignage qu’il fallait. Alors que tous ont les yeux aveuglés, toi seul as les yeux assez ouverts pour me juger avec tant de vérité !"
La réputation de ses miracles se répandit bientôt et saint Budoc dut recommander à son disciple de ne pas, par sa modestie et son souci compréhensible de se retirer des regards du monde, " éteindre la lampe que Dieu Lui-même a allumée, d’être condamné comme détenteur d’un unique denier, et de tenir pour superflus les dons de Dieu qu’Il a voulu que tu aies gratuitement ".
Parmi les miracles de Guénolé, on compte la guérison de l’œil de sa sœur, arraché par une oie, le miracle des serpents chassés de la contrée, la résurrection d’un enfant tué par un cheval et celle de la mère d’un de ses moines et celle d'un écuyer de son père, et bien d’autres encore.

Statue de saint Guénolé. Eglise Saint-Guénolé de Locunolé.
Après quelques années auprès de saint Budoc, Guénolé fut pris du désir de s’en aller visiter saint Patrick en Hibernie (Irlande). Une nuit, il eut la vision du saint irlandais resplendissant, qui le dissuada de mettre son projet à exécution, mais le prévint qu’il devrait bientôt quitter l'île des Lauriers. Le lendemain, saint Guénolé s’ouvrit de cet événement à saint Budoc, qui, avertit lui même de la pertinence de la vision qu'avait eu saint Guénolé, lui recommanda d'obéir à saint Patrick, et, ayant choisit onze des plus saints religieux et ayant fait saint Guénolé leur supérieur, quoiqu'il n'eût que 21 ans, donna sa bénédiction à tous pour partir fonder un monastère.
Le petit groupe, guidé par la Providence, s’en alla vers la Cornouaille, et s’installa sur une île inhospitalière à l'embouchure de la rivière d'Aven, nommée Ti-Bidi (maison des prières). De l’île, se découvrait au loin le panorama de ce qui allait devenir plus tard Landévennec et les moines conçurent le désir de s’installer en ces lieux. Ils étaient cependant inaccessibles à pied, et c’est par la prière de saint Guénolé, qui tel Moïse ouvrit les eaux, que le petit groupe gagna ce qui allait être leur nouvelle retraire. Guénolé y fit jaillir une source, et la vie monastique s’organisa, les moines se multiplièrent.
La règle monastique, sur le modèle irlandais était sévère. Homme de prière, pétri de la lecture des psaumes, saint Guénolé fut aussi tourmenté par les démons, qui d’après les témoignages de ses voisins de cellule le visitèrent certaines nuits et recevaient de lui semonces et belles réponses. Guénolé se distinguait par la sévérité de sa vie ascétique : il ne s’asseyait jamais à l’église, usait pour son vêtement uniquement du poil de chèvre, dormait à même le sol, une pierre sous la tête, prenait pour nourriture le strict nécessaire, mêlant de la cendre à son pain quotidien, ne mangeant que deux fois par semaines au cours du Grand Carême. Il guérissait les malades et on venait à lui de toute la contrée, recevoir réconfort et demander guérison. Les moines furent un jour témoin de la visite de Notre Seigneur Jésus-Christ, sous la forme d’un lépreux venu demander secours. Devant Guénolé, qui n’avait pas hésité à s’humilier pour guérir le malade, le pauvre devint resplendissant disant :
" Vous n’avez pas rougi de moi dans mes détresses, je ne rougirai pas de vous devant mon père."
On doit aussi à Guénolé la conversion de trois voleurs, venus cambrioler le monastère à l’heure de Prime. Arrêtés par Dieu dans leurs larcins, ils remirent leur vie entre les mains du saint moine, en demandant à être reçu dans la communauté.
Le roi Grallon, ayant eu connaissance de Guénolé, voulut le rencontrer. Ce roi n’était pas sans reproche et avait un caractère dur et violent. Il se mit à fréquenter les moines, et, après plusieurs entretiens particuliers avec saint Guénolé, fut touché et réforma heureusement son caractère impérieux mais dont le fond était bon et porté à la justice.
Saint Guénolé commanda au roi d’abandonner aux flots sa fille, coupable de nombreux vices et ayant corrompu la ville d'Ys. La légende comporte sans doute une part de vérité, celle de rappeler en particulier un cataclysme historique, qui sous la forme d’un gigantesque raz-de-marée, dévasta et ravagea les côtes de l’Armorique et probablement des îles sur lesquelles il ne faut pas exclure qu'y furent bâties. Rappelons à ce sujet, et pour étayer notre propos, que la baie du Mont-Saint-Michel fut inondée et envahie par les flots quelques siècles plus tard dans des conditions similaires et que les hauts-fonds en conservent encore les traces sous la forme d'anciens villages et monastères aujourd'hui immergés.
Dès lors, Grallon se retira à Landévennec, où il vécut jusqu’à sa mort. La vieille église romane conservait un tombeau que l’on disait celui du roi.
Parvenu à un âge vénérable, saint Guénolé reçut l’annonce de sa mort, et commanda à ses frères de se préparer. Selon la tradition codifiée au XIe siècle, il désigna pour lui succéder saint Gwenhaël. Ayant lui-même célébré la Liturgie et communié, chantant des psaumes et des cantiques debout devant l'autel et porté par deux de ses religieux, il rendit l’âme le mercredi de la première semaine de Carême, qui était le trois mars, et qui, selon le cycle Victorin, convient à l'an 504, où Pâque fut le 11 avril.
Les reliques de saint Guénolé reposèrent en son abbaye jusqu’aux invasions normandes qui dévastèrent l’abbaye dans les années 913. Les moines fuyèrent alors la Bretagne, et la toponymie permet de suivre leur périple : on trouve quelques paroisses dédiées à saint Guénolé sur les rives de la Manche. Les moines furent invités à rester à Montreuil-sur-Mer, où ils fondent une abbaye portant le nom de saint Walloy, déformation flamande de Guénolé. Une partie des reliques fut disséminée dans diverses paroisses de Bretagne et du Nord. Une partie a été perdue à la Révolution, certaines sont revenues à Landevennec, à la réouverture de la nouvelle abbaye.
L’origine du nom de Landévennec est discutée : certains proposent Lan-tevennec, l’ermitage de la falaise, d’autres proposent Lan-to-Winnoc, l’ermitage de Guénolé.
00:15 Publié dans G | Lien permanent | Commentaires (0)